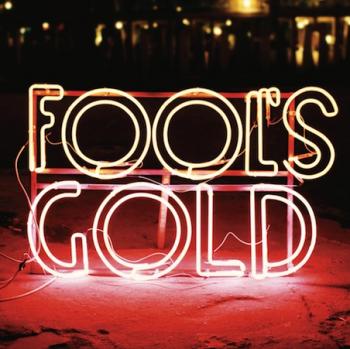
Apparu dans le sillage d’autres formations et artistes américains influencés à des degrés divers par les musiques africaines (Vampire Weekend, Dirty Projectors, Yeasayer, Tune-Yards…), le collectif angeleno Fool’s Gold s’est distingué d’emblée en étant avant tout un (excellent) groupe de scène. De fait, leur premier album, sorti en 2009, apparaissait comme une déclinaison de leurs concerts, avec un minimum de polissage en studio pour rendre les morceaux présentables. Le disque, qui recueillit un beau succès critique, public et radiophonique, séduisait justement par ce manque d’apprêt, un aspect un peu rugueux qui donnait parfois l’impression d’écouter un volume inédit de la collection « Ethopiques ». Il était toutefois logique, voire souhaitable, que Fool’s Gold évolue vers une musique peut-être un peu moins spontanée, mais plus construite et travaillée. Le résultat s’intitule « Leave No Trace », et porte plutôt mal son nom.
Luke Top et sa bande – réduite ici à un quintette – ont opéré un recadage qui pourra apparaître légèrement commercial (morceaux plus courts, chantés en anglais plutôt qu’en hébreu, son plus rond), mais qui met en évidence les qualités d’écriture déjà discernées sur l’album précédent. Comme « Fool’s Gold », qui s’ouvrait par la doublette gagnante « Surprise Hotel »/ »Nadine », « Leave No Trace » démarre très fort, avec les tubesques et joyeux « The Dive » et « Wild Windows », le genre de morceaux qu’on aimerait entendre le matin à la radio pour se convaincre que la journée ne va pas être totalement pourrie. Du coup, le funk synthétique de « Street Clothes », qui suit, paraît un peu poussif malgré les belles parties de guitare de l’excellent Lewis Pesacov.
On craint un instant que la rutilante machine à danser mondialisée ne se mette à tourner un peu à vide, mais le morceau-titre nous rassure tout en opérant un intéressant pas de côté. A l’évidence, le groupe a réécouté du rock indé des années 80, et notamment les Smiths dont la mélancolie vibrante semble avoir légèrement imprégné leur propre musique. Grand écart ? Pas tant que ça quand on se souvient ce que le jeu de guitare de Johnny Marr devait au « highlife » d’Afrique de l’Ouest… Par ailleurs, même dans la langue de Morrissey, le chant de Luke Top, parfois soutenu par les chœurs fervents de ses camarades, garde des accents orientaux qui singularisent d’emblée le groupe. Et sur « Bark and Bite », qui sonne comme un hommage au « jive » sud-africain des années 60-70 ou à la rumba congolaise, s’immiscent de discrets effets électroniques très actuels.
Si l’on peut reprocher à Fool’s Gold quelques facilités de temps à autre, au moins le groupe évite-t-il habilement deux écueils sur lesquels il aurait pu se fracasser : l’excès de purisme conduisant à imiter servilement les grands anciens, et, à l’opposé, le mélange sans discernement d’influences disparates, histoire de ratisser le plus large possible. Les Américains ont su trouver le juste milieu, et il en résulte un disque qui est pourtant tout sauf tiède et centriste.
