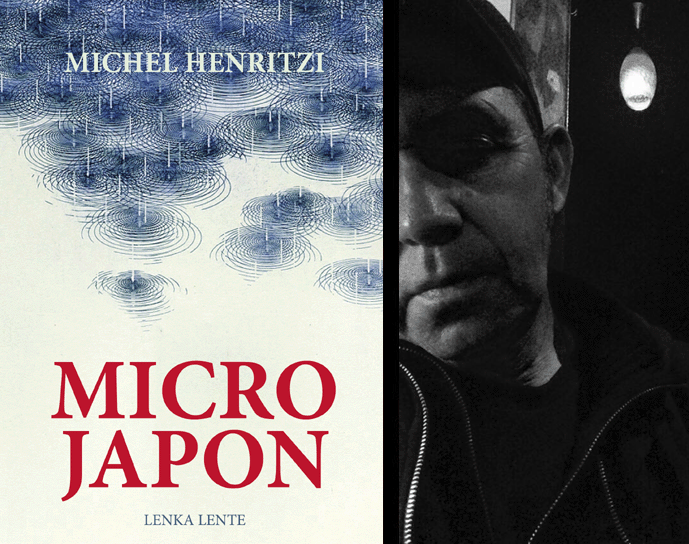Le Japon… Terre de contrastes, d’étrangetés en tout genre, terre de fantasmes aussi, véritable eldorado pour les esprits libres et humus fertile pour les musiques expérimentales, improvisées, voire tout simplement en dehors des sentiers battus. Ce qui est fascinant, c’est que plus on s’y intéresse, plus on s’y perd. On peut avoir fréquenté assidument Bimbo Tower, dévoré Barthes (L’Empire des signes) ou Bouvier (Chronique japonaise), battre (pas si mal) son matcha tous les matins et boire du thé ombré toute la journée, collectionner des céramiques de la famille Kudo, connaître son Ozu sur le bout des doigts, on reste toujours comme un éléphant dans un magasin de porcelaine à chaque cérémonie du thé, emprunté devant chaque autochtone rencontré et submergé dans la discographie pléthorique des Keiji Haino, Merzbow ou Tori Kudo, pour n’en citer que quelques-uns. Les boussoles sont rares et anglophones pour la plupart (The Wire et Saint Alan Cummings par exemple). En France, depuis plus de 20 ans, Michel Henritzi (né à Metz en 1959) a relevé ses manches et est allé au charbon pour divers médias dont Revue & Corrigée. Avec douceur, humilité et érudition, il a tenté d’approcher les mauvaises graines de la musique, d’interroger leurs pratiques, de rechercher leurs influences, de définir leur questionnement. Bref d’organiser une rencontre entre l’Orient et l’Occident et de vérifier si cette grille de lecture binaire est pertinente. Tâche ardue et amplement gagnante à lire la somme des 400 pages d’interviews rassemblées dans ce Micro Japon publié récemment chez Lenka Lente. Au final, c’est une collection d’instantanés d’épiphénomènes qui définissent une carte mouvante dans l’espace et le temps mais également un portrait de l’auteur, passionné de musiques alternatives et surtout praticien lui aussi (Dustbreeders, O’Death Jug…), ce qui enrichit considérablement le regard et modifie le rapport interviewer/artiste.
Voilà un ouvrage passionnant pour qui s’intéresse à ces musiques bis mais aussi aux mouvements artistiques post-Seconde Guerre mondiale et de manière plus globale au Japon. Le livre est d’autant plus attachant qu’on n’est absolument pas dans une somme définitive : il offre un état des lieux des années 50-60 à aujourd’hui qui ne demande qu’à être enrichi et modifié. Nous avons voulu soumettre (gentiment) Michel Henritzi à la question lui-même, et il s’est exécuté avec le même souci de mesure, de clarification et d’intelligence. Cadeau bonus en bas de page : une liste d’écoute fournie par l’auteur du livre pour se plonger dans les musiques du Micro Japon.

Comme tu commences souvent tes interviews comme cela, je te pose ta question rituelle : quel est ton premier souvenir musical ?
J’ai abordé beaucoup de ces entretiens par cette question d’un souvenir musical qui pourrait être déclencheur d’un désir de musique, qui annoncerait un cheminement partant d’un premier émoi musical vers leur musique en devenir. C’est sans doute un fantasme de croire qu’il y aurait un « son » premier que l’artiste essayerait de retrouver et de préserver tout au long de sa carrière. Je crois que ce qui déterminera leurs parcours arrivera bien plus tard dans leur vie, à l’adolescence voire encore après, chacun a une réponse différente.
Quant à moi, mon premier souvenir est assez banal, il s’agit des « Quatre saisons » de Vivaldi qu’on écoute en classe de musique. Je suis encore gosse, mais je crois que le son qui m’a le plus marqué c’est celui des cloches sonnant les offices religieux que j’associais sans doute inconsciemment au temps qui passe, à la mort. Sentiment que je retrouverai plus tard dans la culture japonaise à travers ce concept zen de l’impermanence, du mono aware, qu’on pourrait traduire par : mélancolie du présent. Ce son de cloche je l’entendais comme un son musical, ou tout au moins comme faisant partie d’un rituel sonore qui annonçait notre finitude. Ce qui me mettait et me met toujours mal à l’aise. Le premier disque qui m’ait vraiment remué c’est peut-être « A Saucerful of Secrets » de Pink Floyd, en tout cas un des premiers disques rock/pop que j’achète. Un ami m’initie à toute cette pop anglo-saxonne : Deep Purple, King Crimson, Uriah Heep, Iron Butterfly, Soft Machine, Rolling Stones, Can, et de mon coté je m’intéresse à Léo Ferré avec le groupe Zoo, Catherine Ribeiro, Catharsis, Ange, la musique classique, Beethoven, Bach et Bartók surtout.
Par la suite, quel est le parcours musical qui te conduit à te pencher plus en avant vers la noise et les musiques expérimentales ?
J’ai étudié la guitare classique étant gamin, je détestais les cours, le solfège, les contraintes liées à l’étude, au point que je ne bossais mes partitions que l’heure précédant le cours. Quand arrivent les punks en 76, j’ai 17 ans, je me reconnais dans leur boucan qui me semble proche de ce que je ressens, de ce que je veux exprimer. La musique me semble tout à coup devenir accessible et ouverte, débarrassée de ses contraintes et interdits. Mais très vite, je me rends compte que la scène punk est assez réactionnaire, au point qu’aucun de mes copains ne veut de moi dans ses groupes, on me reproche de n’avoir aucune technique, de ne pas tenir un rythme ! Ce qui me perturbe beaucoup ! Je croyais naïvement que les punks envoyaient balader tout ça, qu’il s’agissait juste de prendre une guitare en main et de jouer. Par hasard, je découvre Throbbing Gristle et la musique industrielle qui même si elle reste musicale factuellement (on y entend encore mélodie et rythme), est tournée vers l’expérimentation. Je peux dès lors m’essayer à mon tour à bricoler dans mon coin une musique bruitiste libérée des contraintes du rock, ce que je fais avec des magnétos cassettes et une guitare. Et puis comme je le dis dans le bouquin, je tombe sur le disque de Hijokaïdan « No Paris, No Harm » et là c’est comme se retrouver face à un trou noir, toutes nos définitions de ce qu’est la musique ne sont plus opérantes, on bascule dans un truc inouï, inconnu, dans une sorte d’extrême contemporain qui fascine totalement ou alors qu’on rejette violemment. A cette époque, je lis aussi beaucoup de littérature sur l’art contemporain, sur Dada, Fluxus, les Nouveaux Réalistes… et la musique me semble très en retard avec la radicalité de l’art contemporain, très réactionnaire, fasciné par son spectacle, ses gimmicks. La musique industrielle introduisait dans la musique occidentale un questionnement politique et esthétique qui me semblait proche de celui qu’on trouvait dans l’art contemporain. Côté littérature, il y a Burroughs, Artaud, Bataille, que je dévore. On ne se plonge pas dans ces bouquins sans en être affecté, questionné. La noise vient plus tard. Pour moi, c’est dans la continuité de mon intérêt pour la musique industrielle, du fait qu’elle lui est connectée à travers le réseau du mail art notamment et quelques fanzines qui commencent à en parler. Ce qui m’amènera à en avoir une lecture faussée à cette époque, ma compréhension de la noise passant par une grille de lecture calquée sur ces musiques subversives occidentales, j’articule tout ça trop légèrement, peut-être naïvement, à Jacques Attali, Jean Baudrillard et Burroughs. On est loin du compte. Tout cet extrémisme bruitiste me fascine, en connexion avec mon désir de radicalité et d’ouverture sur l’inconnu, et surtout il me débarrasse d’un complexe lié à une limitation technique. Le mot d’ordre c’est juste « Do it yourself », il n’est plus question de reproduire la musique de ses idoles. Bien au contraire, le mot d’ordre aurait pu être celui qu’apportera Sonic Youth quelques années plus tard avec « Kill your idols », ça me permet de me sentir libre face a ce truc imposant : la Musique.
Fais-tu le distinguo entre jazz, free, musique contemporaine, expérimentale et noise ou, pour toi, tout joue-t-il sur le même plan disons contestataire d’un ordre établi ?
Oui bien sûr que je fais un distinguo, déjà entre jazz et free jazz, le free est la critique du jazz, une musique qui s’est institutionnalisée, qui est devenu très conformiste, musique d’ascenseur très présente au Japon. Rappelez-vous l’accueil fait à Ornette Coleman qui va jusqu’à se faire briser les dents par un public qui ne comprend pas et rejette violemment sa musique. Entre le free et le contemporain il y a là aussi des désaccords, des incompréhensions, même si il y aura de nombreuses tentatives de collaborations, particulièrement au Japon. Les musiciens ne sont pas issus d’un même milieu social, soutenu par les mêmes institutions. Et très schématiquement on pourrait opposer l’approche très intellectualisée et abstraite de la musique contemporaine à une approche plus viscérale, empirique de la musique free. Quant à la musique noise, tout dépend à laquelle on fait référence. S’agit-il de sa branche fondatrice japonaise ou sa version occidentalisée ? Au-delà de ces différences d’approche, il y a effectivement un questionnement d’un ordre sociétal, tout au moins des académismes du monde de la musique et de l’usage de la culture dans notre société occidentale comme « marchandise idéale, celle qui nous fait accepter toutes les autres », pour reprendre Debord. Cependant, toutes ces formes qu’on continue à enfermer dans des genres, des classifications, souvent par commodité, portent en elles de formidables propositions nouvelles. A l’époque de leur émergence, elles apparaissent comme un débordement radical des académismes, du discours dominant culturel. Même si aujourd’hui elles font partie de l’Histoire et n’ont plus ce pouvoir de questionnement. Après je ne pense pas que la majorité de ces acteurs se pensaient comme des activistes politiques et voulaient contester un ordre établi, ils s’en nourrissaient aussi. La contre-culture ou plus exactement les cultures alternatives créent leur propre système de pouvoir. C’est ce que reprochera Masayuki Takayanagi à la scène free japonaise, de se préoccuper plus de leurs petits commerces que de musique.
Après toutes ces années d’écoute et de recherches, pourrais-tu définir l’onkyo ?
Onkyo se traduit littéralement du japonais par « son pur » qu’il ne faut pas comprendre à travers sa définition occidentale qui serait un son sans bruit parasite, d’une hauteur fixée et joué parfaitement sur un plan technique, mais plutôt à la suite de John Cage un son qui ne raconterait pas une histoire, dont l’existence ne serait pas conditionné par sa position dans une construction syntaxique, un son qui existe pour lui-même, indépendamment des autres sons qui l’entourent. C’est une question d’écoute, de rapport au temps, où l’instant présent prime sur une projection dans un futur annoncé. C’est aussi une idée que l’on retrouve dans la philosophie zen. Onkyo est un terme inventé par la critique anglo-saxonne qui reprend un propos d’Otomo qui avance ce mot pour présenter un groupe de musiciens actifs à Tokyo auquel il participe, et à travers ce terme l’idée était de donner de la visibilité et de promouvoir une approche collective autour d’une idée nouvelle de ce que pourrait être l’improvisation. Ce groupe qui réunit des musiciens comme Taku Sugimoto, Toshimaru Nakamura, Sachiko M, Ami Yoshida, Otomo… cherche à sortir de certaines conventions de l’improvisation, notamment ce dialogue entre les musiciens, une certaine démonstration technique du jeu instrumental, suivre la mémoire de ses mains, un développement linéaire du temps… Ma définition de Onkyo serait une esthétique du moins, qui approche le matériau musical par le réductionnisme et entretient un rapport très fort au silence, où l’écoute de l’auditeur est participative. Ce qui pourrait définir l’esthétique Onkyo c’est sa relation au temps, son détachement de l’évènement, laissant chaque son définir l’espace de l’écoute. Il y a une proximité avec la pensée de Cage qui définit la musique comme du temps, on pense aussi à AMM qui fait un travail de surfaces, de plans qui se contaminent. Beaucoup d’entre eux choisiront une instrumentation électronique qu’ils emploient à contre-emploi et qui surtout élimine l’affect du musicien et sa virtuosité, qui est très présente dans l’improvisation. Sachiko M joue d’un sampler sans mémoire, Nakamura d’une table de mixage bouclée sur elle-même, Otomo de platine sans disque. On peut aussi y voir la critique des outils de la techno culture, d’un certain post-modernisme afférent aux nouvelles technologies. Onkyo est devenu un dogme, une pratique idiomatique qui s’est répandue de Tokyo à Berlin, de Boston à Londres. La plupart de ces artistes en sont sortis d’une manière ou d’une autre. Cette musique m’a profondément touché, c’est comme regarder une calligraphie, la trace d’un simple geste sur une feuille blanche.

Ton livre, qui s’étale sur presque vingt ans de propos recueillis, trace aussi en filigrane un portrait de toi. Tu sembles, au fil des années, plus nuancé ou retenu, notamment sur les implications politiques de la noise ou sur l’identité de la musique japonaise. Est-ce que tu as appris à te méfier des formules toutes faites et/ou des artistes nerveux sur le sujet, ou est-ce ton regard sur ces questions qui a changé ?
Je suis allé dix-huit fois au Japon, j’ai eu une résidence de plusieurs mois à Kyoto, on pourrait penser que j’ai de ce fait une connaissance profonde du Japon, mais j’ai le sentiment que plus je connais le Japon moins je le connais. On n’échappe pas à cette lecture ethnocentrique qui est la nôtre, le Japon reste l’autre, un exotisme radical. C’est vrai que mon regard est plus nuancé et prudent qu’il n’a été. J’ai depuis lu beaucoup de choses, échangé et pu discuter avec de nombreux musiciens ou amis japonais qui m’ont fait comprendre que je n’échappais pas à certains clichés qu’on peut avoir sur le Japon, qu’on a pu nous vendre comme des vérités intangibles de ce qu’est le Japon. Je crois que si on ne parle pas la langue, on restera toujours en bordure de leur culture. Ce qui est mon cas. Je prends l’exemple des musiques traditionnelles qu’on nous présente comme l’âme japonaise, de fait c’est une construction de l’ère Meiji qui a codifié ces musiques et qui représentent chacune une classe sociale déterminée, qui n’est donc pas représentative d’une âme japonaise unique et immuable, pourtant on continue de voir ces musiques comme la quintessence de l’esprit du Japon. Je continue d’apprendre tous les jours sur la musique qui se fait dans ce lointain. Il faut garder aussi à l’esprit que toutes ces musiques (contemporaine, free jazz, noise, psychédélique…) ne sont pas représentatives d’une contre-culture significative de la société japonaise, elles ont souvent plus d’écho ici en Occident qu’au Japon. Je reviens aussi sur cette question de l’identité japonaise, c’est une vraie question, qu’on ne poserait pas si on parlait de musiciens français ou américains. Comme d’essayer de lier ces musiques actuelles à leurs traditions, c’est artificiel. Je me vois mal demander à Sister Iodine ou Lionel Marchetti si la musique des troubadours ou Mozart a d’une certaine manière influencé leur musique, pourtant cette question me semble naturelle face à un musicien japonais. Pourquoi ? L’autre aspect de cette question, c’est qu’il est aussi paradoxal d’évoquer une identité japonaise à l’encontre de pratiques expérimentales qui par définition remettent en question cette même identité. Mais bien évidemment toute musique n’échappe pas à son contexte historique, géographique, social, culturel… Pour revenir à la noise, c’est un courant musical qui n’est pas homogène ni sur un plan formel, ni sur un contenu. Si Masami Akita, Toshiji Mikawa ou Tetsuo Furudate ont un discours très intellectualisé sur la musique noise, c’est moins vrai pour Jojo Hiroshige ou d’autres comme Masonna, Gerigerogege, Aube … J’ai appris à me méfier d’un discours généraliste sur les genres. C’est différent entre chaque artiste, chaque époque, chaque région. Akita par exemple est très critique vis à vis des nouvelles générations qui se sont emparés de la noise à la façon des groupes de rock’n’roll qui reprennent le répertoire d’Elvis. Un noiseur aujourd’hui qui reprendrait les mêmes stratégies et instrumentarium que Merzbow, en quoi serait-il dans une démarche critique et échapperait au conformisme ambiant ? C’est bien la fin de l’Histoire, non ?
J’ai été surpris des précautions que tu prends lorsque tu vas à la rencontre de ces artistes, des gens vraiment pas simples (et tant mieux) comme Keiji Haino, pas facile, et Tori Kudo, toujours aussi sibyllin. Tes angles sont littéraires, politiques, philosophiques, et tu as pris soin de t’immerger aussi dans la culture japonaise et ses concepts (le ma, le wabi sabi…). Pourtant, certains artistes se ferment presque totalement sur certains sujets, ne t’autorisant pas, finalement, à questionner, certains se retranchant même derrière le rideau de l’orientalisme impossible à comprendre des Occidentaux (quand bien même ceux-là connaissent sur le bout des doigts la littérature et la philosophie occidentales). Comment analyses-tu cela ? Est-ce que cela modifiait alors ton rapport à la personne et à l’artiste ?
C’est très juste ce que tu dis là, certains de ces artistes se ferment à mes questions, particulièrement aux questions qui touchent des sujets profonds, sensibles (politique, japonité, traditions …). La première raison, je crois, est qu’ils ont peur d’être mal compris et interprétés du fait qu’on échange dans une tierce langue : l’anglais. Si déjà mettre des mots sur la musique est une traduction, traduire du japonais à l’anglais puis au français porte le risque de fausser leurs réponses. Ce que je peux comprendre, parfois mes questions étaient aussi trop abstraites dans leur traduction, laissaient trop de risques d’interprétation. Parfois, ils ne percevaient pas mon intention de les provoquer pour les amener à répondre de façon plus argumentée, ils pouvaient penser que mon regard sur leur musique était simpliste, erroné. Cela apparait plusieurs fois dans les entretiens avec Masami Akita et Jojo Hiroshige. Les musiciens de cette scène noise sont particulièrement suspicieux quant à notre regard sur leur musique, je dirais presque paranoïaques : il y a comme une appréhension chez eux qu’on continue à en parler comme d’une aberration sonore et qu’on lui refuse cette acceptation d’être aussi musique. Il faut aussi reconnaitre que les médias occidentaux ont présenté leurs musiques de façon très simpliste et souvent limitée à son caractère de scandale, notamment en se focalisant sur l’imagerie pornographique de certains disques, ce qui est très loin de représenter l’essentiel de l’imagerie liée à la noise. Je ne peux que blâmer le fait que je ne parle pas leur langue. Je crois qu’on aurait pu aller beaucoup plus loin dans nos échanges si cela avait été le cas. Un bon exemple est l’entretien avec Mikawa qui a beaucoup écrit sur le sujet et livre au final très peu de choses dans notre échange, pourtant je sais qu’il a confiance en moi et respecte mon travail de passeur. J’ai la chance d’être ami avec Junko ce qui m’a ouvert beaucoup de portes, et malgré tout, il reste un soupçon.

Ton livre arrive, il me semble, à un point historique. Nous ne sommes pas de la même génération (je suis plus jeune que toi), je viens d’une culture résolument pop, ayant vécu une adolescence portée par l’apogée du disque CD, de la scène dite indépendante, qui vivait ses derniers moments, en marge du système global, mais profitant des atouts des uns et des autres. À la marge de la marge, la scène que tu observes dans Micro Japon a commencé de m’enthousiasmer au même moment que tu commençais à interviewer ses protagonistes. Là encore, cette marge se nourrit des restes d’un système mainstream. Tu recueilles alors les confidences de demi-dieux ancestraux de la scène avec Keiji Haino, Masami Akita de Merzbow, suit les nouvelles stars Taku Sugimoto, Yoshihide Otomo et les éternels (et passionnants) seconds couteaux comme Tetuzi Akiyama. On a l’impression d’un arc qui se ferme aujourd’hui, comme s’il fallait tirer un bilan. Est-ce ce que tu ressens ? Si oui, comment l’expliques tu ? Y a-t-il eu au début des années 2000 une appétence plus large pour des sons « autres » en regard d’un retour général au rock et de l’affadissement de l’électro ?
Question difficile, et ma réponse repose sur un ressenti plus que sur une analyse. Je disais précédemment qu’il fallait garder à l’esprit que toutes ces musiques se font dans les marges de la culture dominante, du classique à la J-Pop. Il y a un âge d’or où les marges se mêlent à la musique mainstream, les années 60/70. Et puis tout va éclater dans une sorte de tribalisation de la culture : chaque groupe va s’enfermer avec ses codes, représentations, formes, discours. Un autre élément qui me semble expliquer cet effondrement de la scène underground qui a toujours été fragile, c’est Internet. D’un coté, cela donne accès à tout, on peut y trouver les trucs les plus obscurs et rares, mais qui apparaissent sur le même plan que les productions mainstream, il y a une saturation de l’espace social par le culturel, mais à mon sens un culturel vidé de tout discours critique où tout se vaut. Je ne vois effectivement rien émerger en terme de courants, de mouvements. Mais peut-être est-ce aussi lié au fait que je suis coupé des cultures « jeunes » : je ne m’intéresse au rap ou au metal que de façon très périphérique, par exemple. La culture du zapping me fatigue, il me semble qu’on glisse dans un rapport de surface, les jeunes générations ont accès à tout, absolument tout, découvrent Bach en même temps que Borbetomagus, les Beatles et le Wu-Tang Clan, Pierre Schaeffer et James Brown. On mixe tout ça dans un bruit de fond permanent. C’est vrai que lors de mes derniers voyages au Japon, ces dernières années, j’ai rencontré très peu de choses nouvelles, radicales. Au mieux et c’est déjà pas mal, j’assistais à une relecture de choses passées, notamment une réappropriation du free ou du psychédélisme mais pas de coup de poing dans la gueule comme lorsque je découvre la noise, Otomo, les Boredoms ou Keiji Haino à la fin des eighties, ou, avant, Suicide, Mars ou Einstürzende Neubauten. J’imagine que cela viendra mais encore faudra-t-il pouvoir y avoir accès. Le rap semble continuer à proposer des choses intéressantes mais j’y suis peu sensible, j’imagine qu’il doit y avoir des rappeurs radicaux qui bousculent les conventions du genre et sont isolés de cette communauté, mais je ne les connais pas. Le rap sous ses différentes formes est une musique très populaire dans la jeunesse japonaise, la noise non.
Un des aspects les plus tristes du livre est de suivre au long cours certains artistes phares du mouvement, stars ici et éprouvant visiblement les pires difficultés à survivre au Japon. Là encore, la distance Occident/Orient s’accroit davantage dans le champ des perceptions. On avait l’impression, au début des années 2000, d’une véritable vie, avec des artistes que l’on voyait régulièrement dans des salles de concerts (Les Instants Chavirés notamment) ou en tête d’affiche de festivals (subventionnés) et on achetait pléthore de disques en import par mail order ou dans des magasins spécialisés (Bimbo Tower, Wave). Tout cela, une fois encore, semblait très vivant, alors que cela vivotait sans doute à peine et c’est ce que ton livre révèle. Est-ce que cela survivait vraiment grâce à ces lieux fragiles ? Au CD ? Est-ce que la numérisation n’a pas précipité ou du moins aidé à précipiter cette scène dans les limbes ? Sans sortir la boule de cristal, comment vois-tu la suite de la carrière de ces météores qui resteront sans doute dans l’histoire des musiques expérimentales et improvisées et qui aujourd’hui peinent à joindre les deux bouts dans leur pays ?
J’ai vu Keiji Haino en concert à Tokyo devant 10 personnes au début des années 2000, alors qu’il jouait en Europe devant 300. Ces scènes (il faut toutefois écarter la musique contemporaine et les arts sonores liés au monde de l’art) au Japon ont toujours eu un public assez limité en dehors des festivals. Il faut donc relativiser l’importance de ces musiques qui parfois ont eu plus d’impact ici qu’au Japon. Onkyo est un très bon exemple, la plupart de leurs performances se déroulaient devant une poignée d’auditeurs et intéressaient tous les festivals européens d’alors. Par contre il y a une effervescence créative significative de l’après-guerre au début du XXIe siècle, sans doute lié aussi à l’esprit syncrétique des Japonais, leur façon de s’approprier et de transformer toutes les formes importées. Beaucoup de ces musiciens ne sont pas professionnels, ont des petits boulots à coté, le statut d’intermittent n’existe pas et la plupart des concerts sont organisés par les musiciens eux-mêmes louant les salles à des prix prohibitifs. Il n’existe pas cette culture des squats non plus. Ça complique toute cette économie underground. De ce fait, c’est vrai que les festivals ou des salles comme les Instants Chavirés à Paris, la Cave 12 à Genève, le Café Oto à Londres ont eu une grande importance pour ces musiques et qu’aujourd’hui la situation est plus compliquée, vu la multiplicité de propositions auxquelles nous sommes confrontés. L’autre aspect qui est très pervers à mon sens, c’est que la majorité des festivals dédiés à ces musiques procèdent comme les autres festivals mainstream revenant toujours sur les mêmes noms, il y a ici aussi un phénomène de starisation qui se joue au détriment de musiciens peu connus. Combien de festivals invitent Haino, Otomo, Ikeda, Merzbow, Boris, Acid Mothers Temple ? Combien ont invité Urabe, Umeda, Shiraishi, Mukai, Unami, A Qui avec Gabriel, Doddodo, Harutaka Mochizuki ? Le public est tout autant frileux que les programmateurs. Pour autant, je ne suis pas inquiet pour ces scènes sur le plan créatif, chaque époque voit émerger des propositions inattendues, il y a toujours eu des traversées du désert. Par contre, je suis inquiet pour eux sur le plan économique et sur comment exister dans une telle saturation de propositions merdiques. Il y a là pour ces jeunes générations à inventer une nouvelle économie et trouver de nouvelles façons d’apparaitre.

Tu ne manques pas de questionner le rapport à la performance, à l’enregistrement crucial quand on évoque les musiques expérimentales et improvisées. On se souvient du débat qui a agité la scène lors de l’album “Manafon” (2009) de David Sylvian, composant son disque en réorganisant des improvisations de la crème de la crème (John Tilbury, Fennesz, Yoshihide, Nakamura, Akiyama, Keith Rowe, Sachiko M, Evan Parker, etc.). Les uns criant au scandale, les autres au génie (comme moi, et toi ?) et Tilbury de déclarer en substance : « Sylvian a été clair dès le début et très respectueux des participations et… il faut bien que les improvisateurs vivent ». Sans vouloir ressortir Walter Benjamin (ou comme répondait Masayoshi Urabe à une de tes questions très pertinentes sur le théâtre de la cruauté d’Artaud et la violence : « je suis moi et je n’ai ni besoin d’Artaud, ni de Céline »), est-ce que le relatif évanouissement de la scène Onkyo ne suit pas les contrecoups de la (contre)révolution numérique ? Est-ce que finalement l’enregistrement honni, la capture d’un moment n’était pas la condition, paradoxale, de vie ou de survie de ces épiphénomènes ?
Non, pas du tout, les musiciens liés à Onkyo n’ont jamais eu de problème avec la musique enregistrée et pas seulement pour des questions liées à sa documentation mais l’approche studio les a également intéressés. Onkyo disparaît parce qu’à un certain moment les festivals et leurs publics se détournent de cette forme musicale, qui on doit le reconnaitre est très austère et demande une grande disponibilité d’écoute. L’auditeur est ici partie prenante de cette musique, on ne peut pas la consommer comme un papier peint environnemental. Le support numérique est particulièrement adapté à Onkyo, pour les longues durées d’enregistrement qu’il permet et plus encore pour la précision et la clarté de la restitution sonore. Onkyo est une expérience d’écoute avant tout, disque ou concert, ces deux rapports au son le permettent. J’ai toujours pensé que ce que donnait à entendre Taku Sugimoto dans sa musique était sa propre écoute. Il y a toujours quelques musiciens qui travaillent autour de cette esthétique minimaliste au Japon, mais qui n’ont plus de visibilité, les festivals sont passés à autre chose. Par ailleurs, la plupart de ses acteurs historiques se sont détournés de ce qui est devenu une forme idiomatique, un dogme esthétisant. Otomo est revenu à ses premières amours, notamment au jazz (entre autres), Akiyama à l’americana, Taku à la composition, Nakamura au noise, Sachiko M fait des installations… Onkyo survit ici en Europe dans ce qu’on a appelé la New Improvisation, ou tout au moins a pris place dans le vocabulaire de nombreux improvisateurs qui en ont fait une approche de jeu parmi d’autres : Axel Dorner, Jean-Philippe Gross, Jean-Luc Guionnet, Mark Wastell…
Il y a plusieurs figures absentes/présentes dans ton livre comme Kaoru Abe, Toru Takemitsu, Masayuki Takayanagi. Peux-tu nous dire en quoi elles sont importantes pour toi et pour la scène à laquelle tu donnes voix dans ton livre ?
Il y a beaucoup d’absents d’importance en plus de ceux que tu cites, que j’aurais vraiment aimé accueillir dans ce livre, mais qui n’ont pas souhaité répondre pour diverses raisons que je respecte (Takehisa Kosugi, Toshi Ichiyanagi, Phew, Akio Suzuki, Ryoji Ikeda, Harumi Yamazaki, Chie Mukai, Yosuke Yamashita, JA Saezar…), d’autres effectivement sont décédés, mais ils occupent une place importante dans l’histoire de ces musiques des marges. Pour rester sur ces trois noms que tu avances, ils sont des figures emblématiques du champ musical contemporain et du free. Takemitsu est l’un des premiers musiciens qui, après une adhésion enthousiaste à la musique contemporaine occidentale, va s’interroger sur ses racines et va tenter de trouver une voie originale qui s’écarterait d’une certaine forme de mimétisme avec la musique occidentale caractérisant la création musicale de cette époque. Il va tenter de concilier l’Occident et l’Orient, à travers un jeu de miroirs. Il suffit d’écouter sa pièce « November Steps » qui mêle à une orchestration occidentale écrite, le jeu indéterminé de deux instrumentistes traditionnels, comme deux mondes qui se répondent, coexistent, se superposent. On retrouvera certaines idées de Takemitsu chez Otomo et le groupe Onkyo, notamment à travers l’idée de compositions en forme de jardins et de rhizomes. Sa musique de film est aussi incroyable d’inventions, moderne et provocatrice, anticipant le DJing, avec des séquences alternant jazz, bruits concrets, musiques traditionnelles, voix, classique, chansons… Sa musique pour bande magnétique est aussi fascinante. Il me semble que les musiciens contemporains japonais se permettaient plus de fantaisie que leurs homologues occidentaux, qu’ils étaient moins rigides pour passer d’un champ musical à un autre.
Kaoru Abe c’est très différent, c’est un ovni, un mythe presque rock’n’roll, qui va à l’encontre de l’image polie et disciplinée qu’on a pu avoir des Japonais. Il y a cette anecdote très parlante de la tournée japonaise de Milford Graves, où Graves vire Abe en raison de son attitude égocentrique, Abe n’écoutant que lui-même. Suite à ce renvoi de la tournée, Abe revient à un concert de Graves parmi le public et à la fin du set du groupe, il se met à jouer dans les gradins un solo au sax, volant ainsi la vedette à Graves et se faisant ovationner. Il va à l’encontre de l’image qu’on a du Japonais. Son jeu aura bouleversé le free au Japon et va être à l’origine de nombreuses vocations : Otomo, Makoto Kawashima, Harutaka Mochizuki, Rinji Fukuoka… Abe est à la fois une légende glamour et un musicien exceptionnel au jeu écorché, légende alimentée par les journaux à scandales, sa relation sulfureuse avec l’actrice et écrivaine Izumi Suzuki (1949-1986).
La position de Masayuki Takayanagi est très différente, c’est un militant qui a une réflexion politique sur l’art très radicale, à tel point qu’il va s’aliéner de nombreux musiciens issus du free comme lui. Il est un des premiers à initier une réflexion sur le jazz au Japon et à réfléchir à comment sortir du modèle américain, de ses standards. Il crée en 1962 avec Hideto Kanai et Isamu Kageyama le « New Century Music Research Lab » pour développer leurs propres techniques et réflexions sur ce que doit être un nouveau jazz au Japon, débarrassé de ses influences et de ses limitations. Il faudrait faire ici l’histoire du free jazz au Japon pour bien comprendre l’importance de Takayanagi, son engagement et son apport fondamental à ces musiques. Je te renvoie au livre de Teruto Soejima « Free Jazz in Japan, a personal history » (éd. Public Bath). Ce qui importe, c’est qu’il a donné parmi les albums les plus importants du free japonais, notamment ses trois disques en duo avec Kaoru Abe, mais aussi le premier disque de cette histoire à paraître au Japon « Independance, trend on sure ground » et « We Now Create » avec le quartet de Masahiko Togashi en 69 je crois ; titres programmatiques qui annoncent cette rupture avec le cool jazz et le modern jazz qui était à cette époque dominants au Japon. Et enfin, il y a ces dernières années d’activité avec son projet « Action Direct », en résonance avec la scène noise émergente, même s’il réfute l’étiquette « Noise ». Comme Keith Rowe, il met sa guitare à plat sur table, la prépare avec des chaines, des objets, joue avec des radios, diffusant des discours politiques, etc. Et au-delà, c’est un guitariste exceptionnel qui reste très lié à la guitare jazz, comme Sonny Sharrock, il est un des rares guitaristes de cette histoire insurrectionnelle du jazz, son jeu est magnifique, qu’il reprenne Coleman, joue de la bossa nova ou implose son amplificateur dans un jeu de feedback.
Il manque quelques têtes à ton tableau de chasse (Chie Mukai, KK Null, Aki Onda, Ryoji Ikeda… j’aurais bien aimé, personnellement, aussi lire une interview de Ken Ikeda). Est-ce que tu ne les lâches pas ? Reviens-tu régulièrement à la charge pour Masami Akita (Merzbow) ou Keiji Haino ?
Je regrette aussi vivement que ces musiciens aient décliné ma proposition, comme je disais plus haut, il aurait fallu que je parle japonais et sans doute auraient-ils accepté. Je continue à solliciter ces musiciens, espérant un retour positif. Je travaille ces temps-ci à un entretien avec Yosuke Yamashita, J.A. Seazer, et je reviendrai forcément à Haino. Il me semble important de reprendre notre entretien, 15 ans sont passés, comment toutes ces années passées sur les scènes internationales ont interrogé sa musique. J’aimerais le bousculer un peu sur son parcours qui me semble plus inégal à travers ses récentes collaborations. Il me semble urgent d’enregistrer les témoignages de plusieurs musiciens avant qu’ils ne disparaissent dans la ronde de la vie : Toshi Ichiyanagi, Yoji Yuasa, Panda (Brain Police), Harumi Yamazaki (Gaseneta), Bide, Masonna… D’autant qu’il existe très peu d’ouvrages sur la musique au Japon. En dehors de livres sur les musiques traditionnelles, on doit trouver quatre ou cinq bouquins dont « Micro Japon », contrairement aux pays anglo-saxons où on trouve de nombreux ouvrages sur les cultures actuelles au Japon et sur la musique en particulier. Sans parler de The Wire qui continue de proposer des entretiens de certaines figures historiques, notamment grâce au travail passionné d’Alan Cummings.
Tu as visiblement tes favoris, Tetuzi Akiyama (2000 et 2006), Yoshiyuki Jojo Hiroshige (2000 et 2019), Yoshihide Otomo (deux fois en 2001) et surtout Taku Sugimoto que tu inverviewes quatre fois entre 1999 et 2020. Ce sont, pour moi, les plus passionnantes parce qu’on perçoit vos évolutions, vos changements d’approche. C’est vraiment un compagnonnage, là ? Peux-tu nous expliquer en quoi ils sont chers à ton cœur, en quoi ils restent toujours passionnants ?
Taku et Tetuzi sont des amis, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je les ai interviewés plusieurs fois. Taku est à l’origine de ma passion pour le Japon : c’est à la suite de son invitation à lui rendre visite à Tokyo que je vais basculer dans cette relation compulsive avec ce pays. Avant ce premier voyage, la musique japonaise m’intéresse au même titre que toutes les autres musiques, ni plus ni moins. Elle occupe une place dans ma discothèque parmi les autres musiques du monde. Barthes disait du Japon qu’il était l’empire des signes. Plus que celui des signes, il me semble que c’est l’empire des bruits. La musique est présente partout, dans tout l’espace social, plus particulièrement dans ces mégalopoles mais aussi dans les villes provinciales. Quand on lit les ouvrages de Pierre Landy, Nicolas Bouvier, Philippe Pons, d’autres récits de voyages, on constate que tous évoquent l’omniprésence du sonore au Japon, la véritable musique du Japon est celle de la rue, de ses bars, de ses galeries marchandes, de ses fêtes de quartier, de ses jardins et de ses temples. Les Japonais ont un rapport très intime à la musique et aux sons concrets. Pour revenir à ces interviews, je me devais de refaire un entretien avec Jojo, il y avait eu trop d’incompréhension entre nous lors du premier entretien. Ma compréhension de la noise avait aussi évolué. Otomo quant à lui avait bougé depuis Ground Zero et Onkyo, il était plus disposé à aborder ses années passées avec Takayanagi et son retour au jazz m’intriguait. De plus, c’est un des musiciens qui s’interroge le plus sur l’histoire de la musique au Japon et au-delà. Il n’a pas de problème pour échanger en anglais, pour débattre, il accepte la contradiction et jamais il ne tient de discours autoritaire. C’était très simple d’échanger avec lui. Quant à Taku, je laisse le lecteur découvrir comment sa pensée évolue sur la musique. C’est quelqu’un de passionnant, sa musique a beaucoup évolué sur ces vingt dernières années, d’une forme d’abstract blues à un radicalisme austère qui était construit sur des principes mathématiques. Il parle de musique merveilleusement bien. Au-delà du fait qu’on s’intéresse ou pas à sa musique, son questionnement nous permet d’appréhender la musique de façon neuve. C’est sans doute le musicien qui m’a le plus influencé même si ça ne transparaît pas dans ma musique.

Tu emploies souvent l’expression « les grands irréguliers » pour parler de Keiji Haino et Tori Kudo, entre autres. Peux-tu nous expliquer cela ?
C’est un concept assez simple, il me semble que Keiji Haino, Kan Mikami, Masayoshi Urabe, Chie Mukai, Tori Kudo et quelques autres sont difficilement réductibles à un genre musical, eux-mêmes réfutent la plupart des étiquettes qu’on leur applique, y compris celle assez floue d’improvisateurs. Leur musique est reconnaissable immédiatement comme étant leur. Ce qui est assez éloigné de cette image du musicien traditionnel attaché à une école, un maître, une voie. Ils sont délibérément hors piste, avec un ego assez marqué, même si Haino se déclare chaman, parmi la communauté des hommes, il marque sa musique profondément de son sceau. C’est sans doute ceux qui m’ont le plus bouleversé, ému, leur musique touche à quelque chose d’universel (malgré un idiosyncrasisme très marqué, une japonité très présente). Comme le blues ou le fado, c’est l’une des plus belles folk musics qui soient dans le sens premier de folk, pas comme genre. Un de mes plus beaux souvenirs est lié à une tournée à travers l’Europe avec Kan Mikami et Kazuki Tomokawa, Mikami chantant a capella des reprises enka en traversant les paysages d’ici. Assister à leurs tours de chant soir après soir, c’est magique. Kudo c’est très différent, on ne comprend jamais trop où il veut nous emmener dans ses discussions, c’est une sorte de dilettante génial qui répond aux questions par d’autres questions à la façon des maîtres zen.
À l’ouverture du livre, je me suis jeté sur mes marottes (Toshimaru Nakamura, Kudo, Haino, Akita, Akiyama..) mais finalement je me suis passionné pour d’autres figures moins éclatantes qui acceptaient de se livrer plus volontiers. Makoto Kawabata (Acid Mothers Temple notamment), dans son approche plus frontale (presque bas du front), dit des choses assez essentielles, de même que les jazzeux dans leur ensemble ou Yasunao Tone (membre fondateur de Fluxus et de l’ensemble d’improvisation Group Ongaku) alors qu’on attendait des paroles plus fortes de la part des stars plus flamboyantes. Comme si finalement l’histoire pouvait mieux se raconter par les figures plus annexes ou plus habituées à questionner textuellement leur activité (dans les universités ou les lieux d’arts). Comme si les stars étaient (ou voulaient être perçues comme…) dans un état de transe inaccessible, maintenue le plus possible à distance pour ne pas dénaturer son essence et la transmettre sur scène ou sur disque. Es-tu d’accord avec ça ?
Globalement je suis d’accord. Cependant de nombreux musiciens ne voulaient simplement pas enfermer leur musique dans des mots. Je crois que c’est aussi une approche très occidentale de vouloir mettre des mots sur toute chose. Un mot dit déjà très mal un objet matériel posé sur un socle devant lui, alors dire un son qui n’est au final qu’une simple vibration éphémère de l’air… Yasunao Tone est issu d’une école d’art, on y fait difficilement l’impasse de l’histoire des formes. Tone a du défendre sa vision d’un art sonore dans un monde musical encore très conventionnel qui ne jure que par le dodécaphonisme (nous sommes dans les années 50/60). Il vit à New York, il parle donc couramment anglais. Pour Yuji Takahashi c’est la même situation, il fréquente Cage, Xenakis, Ichiyanagi, la musique à cette époque est en pleine révolution, en débat permanent, l’académisme vacille partout dans le monde. Soejima (qui est le premier promoteur du free au Japon) accompagnera de nombreux musiciens de cette scène en Europe, il maîtrisait l’anglais mieux que moi. Après je rencontre des personnes comme Chie Mukai qui me répond que tout ce qu’elle a à dire sur sa musique est à entendre dans sa musique, pas dans ses mots. De nombreux musiciens m’ont fait cette réponse, Urabe par exemple. Pour l’anecdote, j’accompagnais Junko pour une tournée en Europe, un jeune universitaire lui avait donné rendez-vous pour un entretien qui devait servir pour une thèse. Il avait préparé un ensemble de questions très intelligentes, très savantes, dans un jargon universitaire. A chaque question posée, Junko me regardait en souriant, amusée de tout ça, et me demandait de répondre pour elle, lui disant que je savais beaucoup plus de choses sur la musique noise et ce qui s’y joue qu’elle. Son approche est purement épidermique. J’ai beaucoup appris avec elle sur ce qui se jouait dans la noise, ça touche au zen, à cette idée de vivre pleinement l’instant présent, libre de tout préjugé intellectuel, suivre son feeling dans l’instant sans interdit. Comme dans la vie on rencontre des intellectuels qui aiment conceptualiser, débattre et d’autres plus humbles pour qui les actes parlent plus que toute théorie, et plus encore chez les musiciens.

Je me suis aussi passionné pour cette relation amour/haine que cette « scène » entretient avec le free jazz, la free music. On constate que les opinions sont assez tranchées sur le sujet, que la question de l’héritage, de la référence est centrale et clivante. Dès que tu tires la carte John Cage ou Derek Bailey, on ne sait jamais ce qui va sortir. Alors, figures tutélaires ou à abattre ? Impasses ou clefs ?
J’ai très souvent remarqué que ces musiciens (et pas seulement ceux liés à Onkyo) n’aimaient pas être comparés ou rapprochés à d’autres musiciens. Le livre de Jeremy Corral « Japanoise – Extremismes & Entropie » (Ed. Les Presses du Réel) met très bien en lumière ce jeu de miroirs entre l’Occident et l’Orient, de quelle façon leurs formes se construisent dans un rapport dialectique à l’autre, et surtout il met l’accent sur la façon dont les Japonais assimilent la culture occidentale très souvent en coupant ses formes (qu’ils japonisent) de ses discours, pour des raisons de langue. Par exemple, le Guitar Sound, la version japonaise du garage, est une forme vidée de son contenu sexuel explicite. Le punk ne porte pas ici la charge politique du punk anglais, même s’il en partage l’extrémisme formel. Les premières années durant lesquelles je fréquentais Taku Sugimoto, il me disait ne pas vraiment connaître la musique de John Cage. Son discours a évolué et il a commencé à reconnaître une certaine influence. Il y avait pourtant des similitudes évidentes, notamment en terme de procédés. Ne serait-ce que dans leur rapport au temps et au silence. Concernant Bailey, la plupart reconnaissent une influence mais qui n’est pas de l’ordre de la technique instrumentale mais plus de la liberté qu’il apporte, cette possibilité de tout faire dans l’espace/temps du concert. C’est aussi ce qui se passe entre Cage et les musiciens contemporains au Japon. Cage les réconcilie avec leurs traditions et s’en inspire lui-même. La boucle est bouclée. Cage a eu une véritable influence, mais comme toute la musique occidentale, les musiciens sont dans un rapport d’attirance et de rejet depuis l’après-guerre. Le Japon reste ouvert et curieux de ce qui lui est hétérogène, il l’assimile et le restitue sous une forme toujours originale.
Pour revenir à cette notion d’histoire du mouvement. On remarque une sorte d’amnésie ou de pudeur, voire de reniement, concernant les engagements politiques qui ont animé ou du moins traversé toute la scène jazz, improvisée, expérimentale. Comme si tout ce qui avait pu se construire contre ou dans une forme alter avait fondu dans une sorte de brouillard appelé « art » ou « expression personnelle ». On a l’impression non pas d’une réécriture de l’histoire (quoique) mais d’une éradication ou plutôt d’une érosion naturelle (du moins, c’est ce qu’on veut nous faire croire). Comme par hasard, comme ici, la dilution commence à se faire dans les années 80. Je suis assez étonné du peu d’informations de la part d’acteurs quasi directs sur les mouvements d’opposition de cette époque. Les témoignages disparaissent au profit d’une légende sans cesse plus fumeuse. Difficile par exemple, en Europe, de savoir exactement en quoi ont consisté les actions politiques d’un Tori Kudo (comme l’engagement religieux de la famille, dont on aimerait savoir s’il était là depuis le départ ou s’il y a eu un glissement). Au contraire, il y a visiblement (du moins c’est la légende !) les jusqu’au-boutistes comme Masayuki Takayanagi, a priori en guerre perpétuelle ou du moins faisant front ouvertement (avec des projets noise comme Action Direct ou avec le titre d’un de ses ultimes albums : “Three Improvised Variations On A theme Of Qadhafi”). Quel regard portes-tu sur ces choix politiques, quels qu’ils soient ? As-tu pu obtenir plus d’informations hors micro, si je puis dire, grâce à tes voyages ou tes relations avec ces musiciens off stage ?
Là encore tu touches à quelque chose de très compliqué, où je ne peux donner une réponse univoque et claire. De qui parle-t-on et de quoi ? Le sujet politique est très compliqué, refoulé chez certains, et pour beaucoup d’autres simplement en dehors de leurs préoccupations. Je ne suis pas sûr qu’il ait eu une grande place dans les milieux du free jazz et moins encore dans celui de la noise. Le Japon comme beaucoup de pays à travers le monde a connu des mouvements de protestation et de défiance du pouvoir très forts dans les années 60, puis tout s’est effondré. Les moments les plus spectaculaires ont concerné le mouvement de protestation contre les accords militaires avec les Etats-Unis (ANPO), l’opposition à l’agrandissement de l’aéroport de Narita et les dérives criminelles de l’extrême gauche (maoïste), ce qui conduira d’ailleurs à ce que les masses ouvrières se détournent du discours de gauche, cela s’additionnant au boom économique. Certains activistes de ces années sont toujours recherchés ou en prison. L’histoire du rock y est liée à travers l’implication du bassiste des Rallizes Denudés dans un détournement d’avion, certains textes aussi très virulents du groupe Zunô Keisatsu. Pour autant il y a peu de groupes qui ont tenu des discours politiques explicites au Japon. Takayanagi est dans un débat permanent mais pour autant il ne se reconnait dans aucun groupe ou parti d’extrême gauche. Yuji Takahashi essaye d’intégrer dans ses compositions des éléments explicitement politiques, y compris dans sa relation entre compositeur et interprètes mais sans rencontrer d’intérêt dans les classes populaires. L’extrême gauche (ici maoïste) rejette les avant-gardes comme étant des préoccupations bourgeoises. Il y a une culture prolétarienne qui ne résistera pas au boom économique et à l’américanisation de la société. Je crois qu’il y a un travail de recherche à faire, j’ai trop peu d’éléments pour m’avancer plus profondément dans le sujet. Pour conclure sur un truc positif, on pourrait souligner que les formes qu’inventent depuis 70 ans, les acteurs du free, de la noise, du psyché, de l’impro sont un langage profondément politique.
À lire d’une traite les presque 400 pages d’interviewes couvrant 20 ans de ta vie, on a l’impression qu’Occidental pétri de sa culture et bien au courant de l’orientale, toujours cherchant et questionnant le sujet, tu t’es, comme un élève zen, débarrassé de tes oripeaux et certitudes pour atteindre un monde flottant. Tu parais à la fois plus calé et encore plus à l’écoute d’autres formes de vie, musicales ou non. Toujours pas blasé ? Toujours en recherche ? Est-ce que cette scène ne te parait pas essoufflée ? Quels sont ceux que tu as lâchés ? Ceux que tu suis toujours avec enthousiasme ? Y a-t-il une relève ?
Blasé ? Non, je ne le serai jamais ! Mais à un certain moment, la musique est devenue un prétexte pour m’immerger plus encore dans le Japon, un Japon ordinaire, quotidien, avec ses contradictions, ses beautés et ses laideurs. J’aime le Japon, c’est un amour profond, j’aime la ville japonaise, même si je me sens toujours étranger là-bas, mais touriste non, j’y ai mes rituels, mes lieux, mes souvenirs, de nombreux amis. J’ai commencé par m’intéresser à la noise et disons les formes extrêmes des musiques qu’on y trouvait pour aujourd’hui écouter essentiellement de la musique enka, kayo kokyu et certains chanteurs singuliers comme Kan Mikami, Kazuki Tomokawa, Haco Yamazaki, Morita Doji, Yoko Ran… Je ne suis plus à la recherche systématique des musiques extrêmes, de ruptures, mon champ d’intérêt c’est considérablement élargi, diversifié.
Concernant l’éventuelle émergence de nouveaux artistes, la difficulté reste d’avoir accès aux sources, non plus en raison d’un accès proprement dit (tout se trouve sur la Toile) mais de se repérer face à la quantité de propositions à laquelle aujourd’hui Internet nous soumet. L’autre difficulté au Japon est de se repérer dans ce foisonnement de salles, galeries, espaces publics qui proposent des concerts : les flyers sont en kanji, les sites le plus souvent aussi, il reste le bouche à oreille, des amis se font l’écho d’un musicien actuel intéressant ou vous parle d’un artiste oublié qui a pu être important, singulier, qui a parfois disparu. Sinon, c’est juste impossible.
Pour répondre à ton autre question, je ne lâche personne, j’aime suivre les musiciens dans leur parcours, et concernant la plupart de ceux présent dans « Micro Japon » avec qui je suis devenu ami, je les suis. Je suis convaincu que la plupart de ces scènes (free, psyché, noise, onkyo) finiront par disparaitre, qu’elles sont toutes liées à l’époque qui les a vues émerger, à une certaine forme de rapport à l’autre, aux choses, qui changent et pas forcément dans un bon sens. Le rapport des jeunes générations à la musique a changé, le disque est un objet obsolète qui demande de s’arrêter, de prendre du temps, eux sont dans le clic and move. Je serai curieux de lire une étude sur les pratiques d’écoute d’aujourd’hui. Je ne dis pas que c’est mal ou bien, je ne sais pas, en tout cas ça ne me satisfait pas.

Question subsidiaire : as-tu la Merzbox (coffret sorti en 2000, date de l’interview, qui faisait baver les fans : 50 CD couvrant la carrière de Merzbow de 1979 à 1997), et si une nouvelle sortait aujourd’hui, l’achèterais-tu ?
Je n’ai jamais eu ce coffret, pas plus d’ailleurs ceux de Hijokaidan ou d’Incapacitants, et je ne les ai jamais cherchés, ni désirés à dire vrai. J’ai pourtant traversé une période d’addiction compulsive vis à vis des musiques japonaises, à chacun de mes voyages je rapportais entre 30 et 50 disques. J’ai toujours préféré découvrir de nouvelles choses plutôt que de me tenir à une forme d’exhaustivité. La plupart de ces disques sont des imports, leurs prix sont prohibitifs parce que longtemps ils n’ont circulé que par des réseaux de collectionneurs. Il y a trop de choses à découvrir pour s’encombrer de ces mausolées.
Enfin, pourrais-tu dresser une courte liste d’albums qui ont constitué le terreau de cette scène ? Les albums phares de la période que couvre « Micro Japon » ? Les quelques pousses d’aujourd’hui qui te semblent germer sur les cendres d’hier ?
C’est une liste sans fin et je continue à découvrir de nouvelles choses, qui ont été oubliées par le passé, rééditées depuis ou qui se font aujourd’hui. Internet nous a donné accès à des documents jusqu’à aujourd’hui introuvables. Ça doit être assez troublant pour les jeunes générations de découvrir dans un même moment, appelons-le X, toutes ces références sorties de leurs contextes historiques. Comment reçoivent-ils tout ça ?
Voici en tout cas quelques références de cette histoire en devenir, criblée de manques, de trous à remplir par chacun en fonction de ses critères, ses goûts et ses intérêts.
TORU TAKEMITSU « November Steps » Decca 2014
JOJI YUASA / KUNIYARU AKIYAMA « Music For Puppet Theater of Hitomi-Za » Omega Point 2005
TAKEHISA KOSUGI « Catch Waves », Sony 1975
GROUP ONGAKU « Music of Group Ongaku », Hear Sound Art 2000
YASUNAO TONE « Solo for Wounded CD », Tzadik 1993
MASAHIKO TOGASHI QUARTET « We Now Create », Victor 1969
MASAYUKI TAKAYANAGI « Action Direct », ALM-uranoia 1987
KAORU ABE / SABU TOYOZUMI « Overhang Party », ALM 1995
YOSUKE YAMASHITA TRIO (feat AKIRA SAKATA) « Mina’s second theme » Victor 1969
MOTOHARU YOSHIZAWA « From the Faraway Nearby » PSF 1993
MAKI ASAKAWA « 浅川マキの世界 » Express 1970
J.A SAEZAR « Kokkyou Junreika », Victor 1973
LES RALLIZES DENUDES « December’s Black Children », No label 1989
KEIJI HAINO « Watashi Dake », Pinakotheca 1981
KAN MIKAMI « I’m the only one. around », PSF 1991
KAZUKI TOMOKAWA « Gleaming Crayon », Modest Launch 2016
MORITA DOJI « Mother Sky » Polydor 1976
KENGO IUCHI « Your crazy Spring Blooms », Brom Rec 1997
CHIE MUKAI « Three Pieces, improvisations », Siwa 2000
HIJOKAIDAN « Romance », Alchemy 1990
INCAPACITANTS « Quietus », Alchemy 1993
MASONNA « Ejaculation Generater », Alchemy 1995
MERZBOW « Rainbow Electronics », Alchemy 1990
MSBR « Spherical Nerve System », GROSS 1996
GASENETA « Sooner or Later » PSF 1991
KAZUO IMAI « How We Will Change » PSF 1995
SLAP HAPPY HUMPHREY « s/t » Alchemy 1994
TENNO (feat TORI KUDO ) « Noise » ALM 1980, réédité par Moone Records en 2021 (lire la chronique ici)
TAMIO SHIRAISHI « Sax solo performance at subway NYC » PSF 2010
MASAYOSHI URABE « Solo » PSF 1996
KOUSOKUYA « Ray Night » Ray Night Music 2007
IKURO TAKAHASHI « Shiri e nai mono to zutto », An’Archives 2017
YOSHIHIDE OTOMO « Guitar Solo Right » Doubt Music 2015
TAKU SUGIMOTO « Opposite » Hat Noir 1998
TOSHIMARU NAKAMURA « No-input mixing board 2 » A Bruit Secret 2001
SACHIKO M « Bar » IMJ 2004
TETUZI AKIYAMA « Don’t Forget to Boogie » Idea Rec 2008
RINJI FUKUOKA / JUTOK KANEKO « Searchin’ For My Layline » Pataphysique 1997
TOHO SARA « s/t » PSF 1995
HOMEI YANAGAWA / MEG MAZAKI « Ghost Story of Yotsuya » Dual Burst 2019
HARUTAKA MOCHIZUKI / MAKOTO KAWASHIMA « Free Wind Mood » An’archives 2018
DOT.ES « Senses complex » Nomart edition 2015
ATSUSHI REIZEN « Untitled », PSF 2012
SARRY « Shiva » Heartless Robot 2017
TETSUYA UMEDA « Ocket » IMJ 2006
KATSURA MOURI « M16 » 2017
ITO ATSUHIRO « Live » Omega Point 2012
AMI YOSHIDA « Tiger Trush », IMJ 2003
KEN IKEDA « Merge » Touch 2003
SHIN’ICHI ISOHATA « The legacy of Frida Kalho », Jigen Production 2015
YUMIKO TANAKA « Tayutauta » IMJ 2013
MICHIHIRO SATO « On a cold, cold night » PSF 2000
AI ASO « Faintest Hint » Ideologic Organ 2020
REIKO KUDO « From Now On » PSF 2009
AKIKO HOTAKA « みずいろ » FMN Sound Factory 2014
UP-TIGHT « The night is yours » Sloowax 2011
LSD MARCH « Constellation of Tragedy » Important 2007
Crédits photos : Michel Henritzi (qui a bien voulu nous ouvrir son album personnel. Encore merci !).
Pour suivre Michel Henritzi :
http://michelhenritzi.canalblog.com
Se procurer le livre Micro Japon (dont il ne reste plus que quelques exemplaires !) :
http://www.lenkalente.com/product/micro-japon-de-michel-henritzi